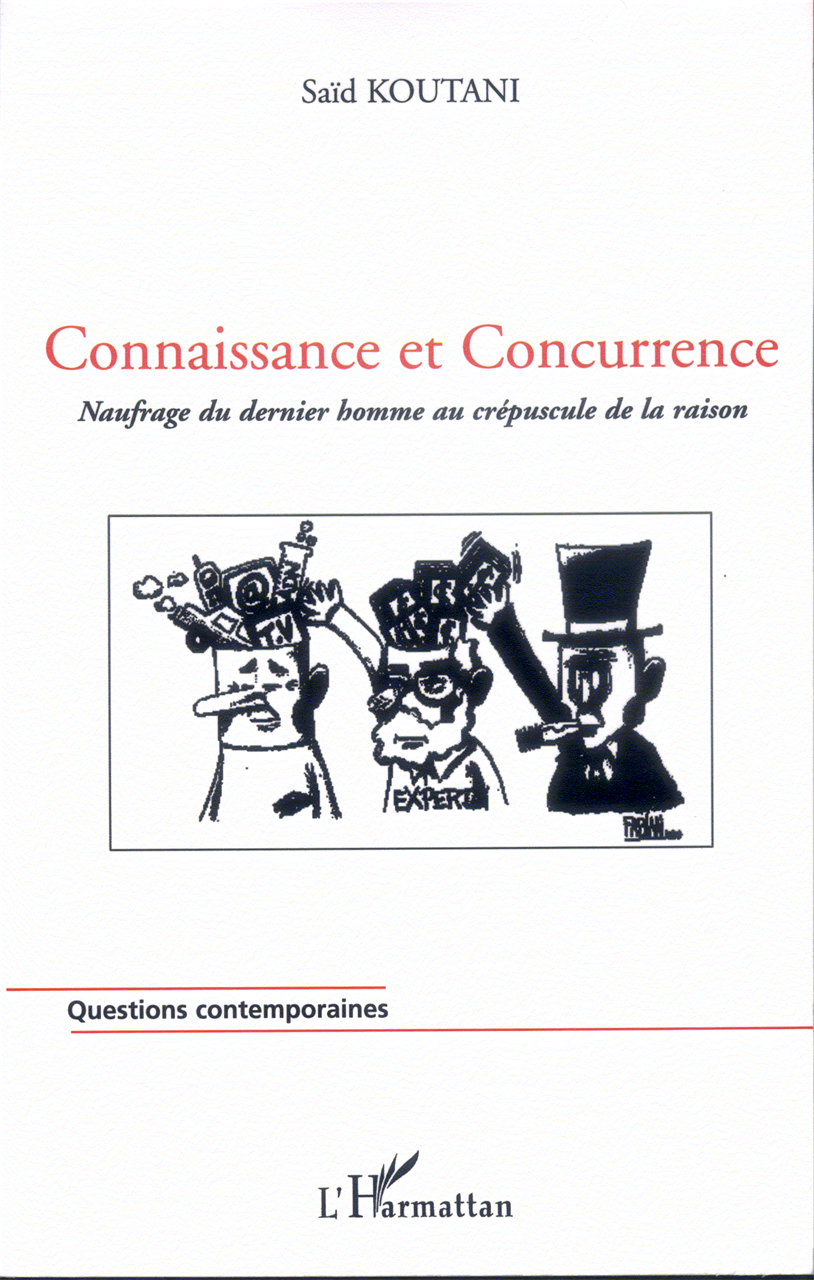EXTRAITS
Nous sommes libérés des contraintes de la production du nécessaire et de l’utile, qui, jusqu’ici, organisait nos jours et hantait nos nuits. Une chance, sans précédent, s’offre à l’homme ; il peut appréhender pleinement son destin. Il peut, enfin, déployer ses efforts dans la création du sens, pour embrasser le sens d’un nouveau progrès et d’un autre épanouissement. Un nouveau progrès qui s’inscrirait dans l’évolution du genre humain. Aussi l’homme évite-t-il paradoxalement cette chance, s’en détourne-t-il, n’affirmant dans sa marche qu’un espoir réduit et battant encore au rythme de la croissance. Si naturels et profondément mélangés à son animalité, l’instinct de survie et la volonté d’expansion ont orienté son histoire avec ses guerres et ses paix. L’homme a troué des montagnes basaltiques et tracé des routes dans le ciel et à travers les océans pour faire circuler ses semblables et leurs marchandises de toutes sortes ; des matières premières aux produits manufacturés, tout ce que les machines extraient des entrailles de la terre et ce que d’autres récoltent ou fabriquent à sa surface à des fins utiles et agréables. Tout circule : du pétrole de la planète entière et du plutonium, des pneus et des souliers, de la viande intercontinentale et du maïs, des carcasses de machines et des gadgets, des antalgiques et des antibiotiques pour nous et notre bétail. L’homme a suivi scrupuleusement la méthode pour réaliser « un monde de bien-être » où la machine incarne et exploite des lois de la nature. Aujourd’hui, la machine dispense - presque - l’homme de son travail, de son énergie et de son temps de travail, pour fabriquer le matériel utile, particulièrement les produits répondant à nos besoins. Nous ne sommes - presque - plus indispensables à nous-mêmes. L’intelligence a structuré un environnement rationnel où la technique domine dans les pays développés tout ce qui relève du prévisible. [...] des Etats ont jadis sculpté l’imaginaire des populations pour extraire, fabriquer et faire tourner jour et nuit des tapis roulants de marchandises minérales et organiques. Ouvriers ou ingénieurs, des escadrons d’écoliers ont été formés pour reproduire l’idéal de la société organisée autour du rendement du travail ; travail de l’homme et travail de la machine. Dompter la machine. Dompter la nature. Dompter l’homme. Il fallait extraire plus, fabriquer mieux et faire tourner plus vite. Mais le processus dévoile sous un grand jour ses limites ; limite de la machine, limite de la nature et limite de l’homme. Le contrôle informatique et à distance de la machine repousse le travail humain, et la nature n’a pas fini de dénoncer la violence de l’ère industrielle. Aujourd’hui, on déconstruit, on déréglemente pour faire place nette à la croissance d’un nouveau monde [...] Les Etats sont, désormais, contraints à la fabrication de nouveaux concepts, de nouveaux paradigmes, pour un autre imaginaire, au moins pour contenir la violence et l’inflation du temps libre.
---------------------------
L’homme n’a pas produit que pour se nourrir, se reproduire et mourir. Sa complexité cérébrale lui a permis d’admettre sa condition singulière de supériorité et de solitude. C’est cette solitude qu’il a cherchée à exorciser en élargissant les pouvoirs de son corps en dehors de lui, même dans un monde apparemment indifférent à la conscience du temps. L’homme confirme sa supériorité en prolongeant ses fonctions en dehors de son corps . Contrairement au mollusque, l’homme a créé et fait évoluer sa coquille ; il prolonge sa peau par des vêtements, des murs, des plafonds et des crèmes contre le froid, les Ultraviolets et la pollution des boulevards. Tout en prolongeant la puissance de ses membres par des roues et des moteurs supersoniques, l’homme s’est attaqué aux fonctions senso-rielles. Avec des capteurs de tout genre, il a voulu et veut toujours capter plus d’informations, avec plus de précision, que ce que renvoient à son cerveau ses yeux et ses oreilles nus. Le ciel ne contient pas seulement des mouettes et des corbeaux ; il est sillonné de satellites qui nous assurent, dans une solitude terrestre, de plus en plus d’instantanéité et d’omniprésence. L’homme affirme sa supériorité cérébrale, mais il ne fait qu’affirmer dans les mêmes proportions sa solitude. L’histoire de l’univers reste indifférente à ses machines et instruments contre lesquels se dressent des murs physiques infran-chissables. Si l’art a prolongé ses espoirs et son désespoir, l’imprimerie a prolongé son cerveau en déchargeant sa mémoire. Depuis Gutenberg, nous avons accéléré l’évolution des supports d’information où se mêlent art et mémoire ; des tors, des bandes, et des disques magnétiques et optiques. Disons avec Manuel Castells que « Les médias sont en quelque sorte inscrits dans le tissu même de notre existence. Nous vivons avec les médias et par les médias » . Nous avons surtout connecté des processeurs et des mémoires et nous nous sommes engagés dans la performance de leur communication.
L’homme est en train de réaliser un réseau d’information à l’image de son cerveau, semble-t-il. Bien que les ordinateurs soient encore faiblement communicants, comparés aux neuro-nes, l’homme balbutie un réseau de neurones électroniques. Ce n’est pas seulement dans les dix mille connexions que réalise le neurone dans le cortex cérébral, ce n’est pas seulement dans le nombre, mais dans les processus individuels et collectifs de traitement de l’information par les neurones cérébraux que la complexité est bien supérieure à celle de nos réseaux informatiques. Nos ordinateurs, leurs microprocesseurs, sont encore dans la civilisation Silicium. Une civilisation carté-sienne, même outre-Atlantique, une civilisation à logique binaire où le peut-être n’a toujours pas de place. Pas pour longtemps, disent les physiciens, bien que le peut-être continue à incarner la politique de la chaise vide dans la technologie Silicium, issue des prétentions rationalistes. Car, avec le développement actuel, on envisage d’atteindre la limite de la technologie Silicium vers 2010. La barre des cent millions de transistors dans un microprocesseur est déjà franchie . Le nombre d’atomes, la quantité de matière utilisée pour représenter une information élémentaire (un bit), diminue exponentiellement en fonction des années. On ne pourra miniaturiser indéfiniment les circuits de nos machines avec le Silicium ; on ne pourra stocker les éléments 0 et 1 de l’information décomposée et assemblée dans un espace ne contenant que quelques atomes. Car, à cette échelle, on devra faire appel à une logique qui intègre l’incertitude. Une logique qui ne sera plus basée sur des 0 et des 1, mais sur des 0, des 1 et des peut-être . Le tout-ou-rien, décomposer et assembler, connecter des parties pour croire au tout, constituent un lourd héritage du XVIIe siècle. De toute façon, le Silicium ignore les angoisses de la solitude.
En 2000, on a dépassé avec la technologie Silicium le Gigahertz. Les puces sont capables de manipuler plus d’un milliard de 0 et 1 par seconde. En attendant une gestion de nos affaires par des microprocesseurs qui intégreront de façon efficace l’incertitude électronique du monde d’en bas, des convergences s’opèrent aujourd’hui à grands pas entre la génétique et l’informatique, dans l’espoir de substituer des brins d’ADN au Silicium. Théoriquement, la représentation de l’information par des molécules d’ADN permettrait la réalisation d’ordinateurs capables de mener de nombreux traitements en parallèle. Des ordinateurs moléculaires seront à l’œuvre ; une œuvre gigantesque à conséquences gigantesques, mais ce ne sera qu’une étape.
---------------------------
Théoriquement, plus une organisation est complexe, et c’est particulièrement la société humaine qui nous intéresse , plus il est difficile, voire impossible, de connaître finement chacun des rôles et chacune des motivations de ses individus, et la nature des relations que ceux-ci entretiennent entre eux dans le temps et l’espace. Il est surtout impossible de prédire les actions individuelles devant un fait nouveau ou les réponses face à un projet que quelqu’un imposerait. S’il y a là une réalité incontestablement propre à tous les systèmes complexes, elle est justement ce qui reste étranger à la pensée rationnelle qui connecte linéairement. Les sociétés humaines ne peuvent que demeurer obscures pour les esprits binaires. Encore faut-il observer que les relations humaines ne sont pas que mutuelles, mais fondamentalement multidirectionnelles, avec une multip-licité variable des motivations et des intentions. L’organisation se présente à l’esprit comme une unité où s’emboîtent les volontés et les actions, elle est incompréhensible sans la considération de sa totalité indivisible. Que fait le rationalisme classique de cette unité caractéristique des mondes emboîtés ? Soigneusement, il découpe et reconnecte les parties. Il n’espère pas retrouver la totalité, il prétend embrasser la réalité. Malgré les précautions, il ne reproduit la totalité ni dans la compréhension de l’unité ni dans la fabrication de ses mondes nouveaux.
Ce constat est aussi celui de Hayek, sauf que ce dernier ne parle pas d’unité ; mais du concept d’ordre qu’il trouve plus approprié, surtout pour traiter d’une société où n’opérerait que le libre-échange. Là, il ne s’agit pas de n’importe quel ordre, là on ne planifie rien, parce que nous ne pouvons rien comprendre à l’ordre humain. Si nous ne pouvons élaborer une connaissance de l’ordre, doit-on souligner, c’est, alors, à l’élaboration, et par conséquent, à la planification de l’activité humaine qu’il faut renoncer. Il se trouve que c’est un renoncement à la connaissance. Seul le marché et quelques règles de conduite que nous avons à adopter pour stimuler la concurrence permettent des connaissances et font évoluer l’ordre. Nous sommes, avec notre connaissance, produits par le marché. Ainsi, pour Hayek « là où nous sommes en mesure […] de modifier au moins quelques-unes des règles de conduite auxquelles les éléments obéissent, nous ne pourrons influer ainsi que sur le caractère général de l’ordre résultant, et non pas sur ses détails. » Il existe des forces ordonnatrices internes à la société humaine, ou forces spontanées selon Hayek, qui agissent dans les relations entre les individus dans des circonstances tellement nombreuses et particulières qu’aucun esprit ne pourra connaître, contrôler ou encore mettre en œuvre. De fait, quel que soit l’esprit qui monopoliserait le pouvoir dans l’organisation, il ne ferait que réduire la multiplicité des forces et la particularité des circonstances ; ses décisions ne pourraient, inéluctablement selon Hayek, travailler que pour un ordre dont la complexité serait largement moindre que dans l’ordre résultant des forces spontanées. De toute façon, si l’on refuse la complexité, on va contre le progrès de la civilisation, et même, très simplement, contre l’évolution au sens général. L’esprit unique, un homme, un parti ou même un Etat légitimé par un suffrage, qui confectionne la totalité de la connaissance, qui n’est au demeurant qu’ignorance, réduit la liberté d’action sous un ordre fabriqué qui empêche l’adaptation et l’ajustement des intentions, nécessaires à l’évolution.
La démarche hayékienne s’inscrit dans une méthodologie systémique, à son tour, très réductrice ; en ce sens que les relations entre les individus dans le système importent fortement par rapport aux individus eux-mêmes . Il s’agit pourtant, peut-on déjà objecter, d’individus conscients des forces ordonnatrices et des règles de conduite, quelle que soit leur nature. Les ordres spontanés, écrit Hayek, « ont un caractère abstrait en ce sens qu’ils peuvent persister alors que tous les éléments qu’ils englobent, et même le nombre de ces éléments, changent. La permanence d’un tel ordre suppose seulement qu’une certaine structure de relations persiste, et que des éléments d’une certaine espèce […] continuent à être entre eux dans une certaine relation. » Ce qui importe sur l’échiquier du libre-échange, ce n’est pas le pion, auquel Hayek incorpore des intentions, mais sa position par rapport aux autres éléments dans la structure du jeu. Si, techniquement, cela peut se résumer à : laissez faire les pions, chacun sait ce qu’il a à faire ; ce qui importe, pour la connaissance, c’est surtout l’ordre qu’aucun élément n’a ménagé et qui est pourtant là, transcendant les détails des intentions individuelles. Ne pouvant, scientifiquement, connaître dans la société humaine les intentions de chacun à un moment et encore moins à tout instant, on ne peut qu’admettre l’ignorance généralisée pour s’intéresser à l’ordre global du jeu et à son évolution. Cette analyse laisse-t-elle encore percevoir une liberté ? Hayek attribue aux individus des intentions, mais, paradoxalement, il leur ôte toute conscience par laquelle la volonté de sortir du jeu du libre-échange reste toujours possible. [...] Ce qui surprend l’entendement devant cette théorie de l’ordre spontané, c’est aussi le corollaire immédiat que tire Hayek de l’impossibilité de la connaissance des détails de l’organisation humaine. On ne peut connaître, donc il faut laisser faire. Et tout le problème est là, d’autant plus qu’il ne s’agit pas de n’importe quel laisser-faire. Hayek ne vise que l’offre et la demande économiques. Ainsi, la concurrence économique se substitue à la connaissance dans l’ultra-libéralisme et la complexité de l’organisation humaine s’y trouve réduite au seul champ de force du libre-échange. Si le constat de Hayek sur la complexité peut être juste, son traitement économiste ruine cette même complexité. [...].
Les économistes classiques défendaient la possibilité de déterminer des lois économiques aussi justes que les lois de la nature, considérées par les sciences classiques comme parfaitement stables. A l’évidence, Hayek ne se situe pas dans le cadre de cette prétention. Il devait probablement savoir que les trajectoires des planètes, par exemple, ne sont pas aussi stables que le laissait croire la mécanique classique. L’ordre du monde est plus complexe que ce que décrit et réduit la connaissance rationnelle classique. En être conscient est certainement une situation encore plus complexe.
©Saïd KOUTANI
Voir les références de Connaissance & Concurrence